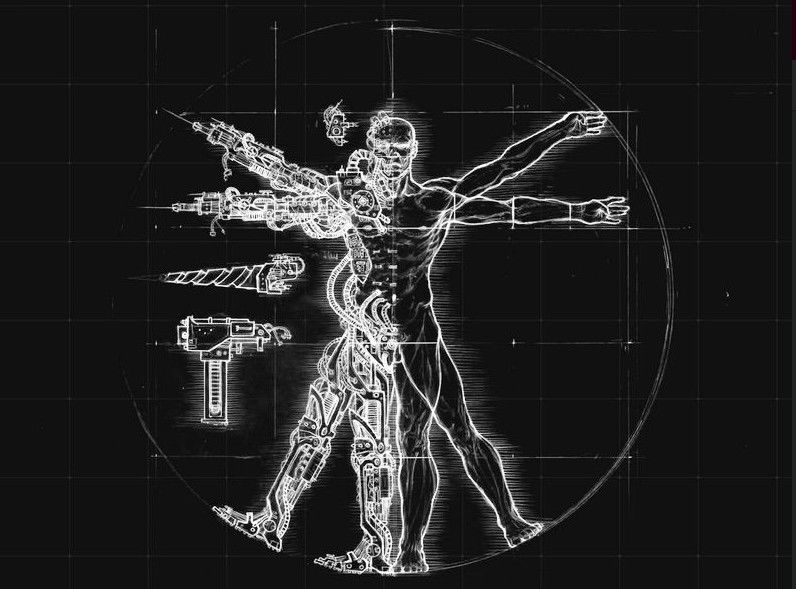
Introduction
Le 21e siècle est le théâtre d'avancées technologiques sans précédent dans les sciences de la vie et la médecine, promettant des bénéfices significatifs pour la santé humaine et la qualité de vie. Ces innovations, allant de l'édition génétique aux neurotechnologies et à l'intelligence artificielle, ouvrent des horizons thérapeutiques autrefois inimaginables. Cependant, elles soulèvent également des questions éthiques et sociétales profondes, notamment celles liées au mouvement transhumaniste. Ce rapport vise à analyser l'intersection entre les lois bioéthiques existantes et les aspirations du transhumanisme, en identifiant les dérives potentielles et les lacunes réglementaires. L'analyse des cadres juridiques et éthiques révèle une tension fondamentale entre l'innovation rapide et la régulation législative, qui tend à être plus lente et réactive. Les lois bioéthiques sont souvent mises à jour après des développements scientifiques majeurs ou des incidents éthiques, comme en témoignent les révisions périodiques des lois de bioéthique françaises ou les conséquences de l'incident He Jiankui en Chine. Le transhumanisme, par sa nature même, anticipe et promeut des changements radicaux et rapides de la condition humaine. Cette divergence de rythme crée un vide réglementaire où les technologies émergentes peuvent se développer avant que des cadres éthiques et juridiques robustes ne soient établis. Cette situation implique un risque accru de dérives non anticipées et rend plus difficile le rétablissement d'un contrôle une fois que certaines pratiques sont établies.
Définition du Transhumanisme et de l'Amélioration Humaine (Thérapeutique vs. Non-Thérapeutique)
Le transhumanisme est un mouvement philosophique et intellectuel qui promeut l'amélioration de la condition humaine par le développement et la mise à disposition de nouvelles technologies visant à augmenter la longévité, la cognition et le bien-être. Il aspire à transcender les limitations humaines fondamentales et à évoluer vers une condition dite "posthumaine", caractérisée par des capacités radicalement supérieures à celles des êtres humains actuels. Une distinction cruciale dans le débat bioéthique est celle entre l'amélioration "thérapeutique" et l'amélioration "non-thérapeutique". L'amélioration thérapeutique vise à restaurer une fonction perdue ou à traiter une maladie, ramenant l'individu à un état de fonctionnement "normal". En revanche, l'amélioration non-thérapeutique cherche à augmenter des capacités au-delà de la norme humaine, redéfinissant ainsi ce qui est considéré comme "normal" pour l'être humain. Le transhumanisme s'intéresse particulièrement à cette dernière catégorie, ce qui constitue un point de friction majeur avec les cadres éthiques et légaux établis. La frontière entre ces deux types d'interventions est souvent floue, ce qui représente un défi éthique et légal significatif. Par exemple, le traitement d'une surdité génétique pourrait être perçu comme une thérapie par certains, tandis que l'amélioration de la vision pour conférer une vision nocturne pourrait être vue comme une amélioration. Cette ambiguïté rend la régulation complexe, car une loi interdisant l'amélioration non-thérapeutique pourrait potentiellement être contournée en présentant une intervention comme une "thérapie" pour une "condition" nouvellement définie. Cette situation ouvre la porte à des "pentes glissantes" (slippery slope), où des interventions initialement considérées comme thérapeutiques pourraient progressivement mener à des modifications plus radicales de la nature humaine.
Principes Fondamentaux de la Bioéthique face aux Technologies Émergentes
La bioéthique, en tant que champ interdisciplinaire émergé dans les années 1960-1970 , se consacre à l'examen des questions éthiques soulevées par la médecine, les sciences de la vie et les technologies associées, en considérant leurs dimensions sociales, juridiques et environnementales. Elle s'appuie sur un ensemble de principes fondamentaux pour guider la prise de décision et l'élaboration des politiques.
Dignité Humaine, Autonomie et Consentement Éclairé
La dignité humaine est un principe cardinal en bioéthique, affirmant que chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques. Ce principe impose de ne pas réduire les individus à leurs traits génétiques et de respecter le caractère unique de chacun. L'UNESCO, par exemple, considère le génome humain comme un patrimoine de l'humanité, devant être protégé et transmis aux générations futures. L'autonomie met l'accent sur le respect de la capacité de l'individu à prendre des décisions, tandis que le consentement éclairé est la condition fondamentale de toute intervention médicale ou de recherche. Un tel consentement doit être préalable, libre et éclairé, basé sur une information adéquate et compréhensible. Des mesures spéciales sont requises pour protéger les droits et intérêts des personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer leur autonomie, comme les enfants ou les individus vulnérables. Le transhumanisme, en proposant des modifications génétiques héréditaires , soulève un défi majeur à ces principes. Ces modifications affecteraient les générations futures, qui, par définition, ne peuvent pas donner leur consentement éclairé. L'absence de consentement pour des modifications héréditaires pose une question éthique fondamentale concernant la "procréation bénéfique". Est-il moralement justifiable d'imposer des modifications à des êtres non encore nés, même si elles sont perçues comme "bénéfiques" par les parents? Cette situation crée une tension entre le désir parental d'améliorer la progéniture et le droit futur de l'enfant à une intégrité génétique non modifiée sans son consentement. La dignité humaine, en tant que patrimoine, est également intrinsèquement liée à la non-réduction de l'individu à ses caractéristiques génétiques.
Bénéficence, Non-Maléficence et Justice
Les principes de bénéficence (promouvoir le bien-être) et de non-maléficence (ne pas nuire) sont des piliers de la recherche biomédicale et de la pratique clinique. Toute intervention sur le génome, par exemple, doit être précédée d'une évaluation rigoureuse des risques et avantages potentiels. La justice exige un accès équitable aux soins de santé et aux technologies, garantissant que les bénéfices des avancées scientifiques sont partagés par tous. Le transhumanisme, cependant, soulève des préoccupations majeures quant à l'accentuation des inégalités sociales. Si les technologies d'amélioration sont coûteuses et ne sont accessibles qu'à une élite, elles pourraient créer une division entre les "améliorés" et les "non-améliorés". Cette situation constituerait une dérive directe de l'application de la technologie sans un cadre de justice robuste, allant à l'encontre du principe bioéthique de justice. La crainte est l'émergence d'une nouvelle forme d'eugénisme, non plus basée sur la race, mais sur la richesse et l'accès aux technologies.
Confidentialité, Non-Discrimination et Vulnérabilité
La confidentialité des données génétiques est un impératif éthique et légal, devant être protégée par des cadres juridiques appropriés. La non-discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques est également un droit fondamental, comme en témoignent des lois spécifiques telles que le Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) de 2008 aux États-Unis, qui interdit la discrimination génétique dans l'emploi et l'assurance. Enfin, la vulnérabilité des individus et des groupes doit être reconnue et protégée. Des mesures spéciales sont nécessaires pour les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de dépendance, afin de garantir le respect de leur intégrité personnelle. La protection des données et la non-discrimination deviennent d'une complexité croissante avec l'intégration homme-machine. Les neurotechnologies et les interfaces cerveau-machine génèrent des flux continus de données hautement personnelles, y compris des informations intimes sur les états cognitifs et émotionnels des individus. Les lois existantes sur la vie privée, telles que l'HIPAA aux États-Unis ou le GDPR en Europe, ont été conçues pour des données plus traditionnelles et peinent à couvrir ces nouvelles formes de données neuronales. La commercialisation potentielle des données personnelles issues de ces dispositifs soulève des risques accrus de discrimination et d'atteinte à la vie privée, nécessitant une redéfinition juridique des "données sensibles". Cette situation met en lumière une lacune réglementaire majeure et la nécessité de cadres juridiques proactifs pour les "neurorights" , une nouvelle catégorie de droits fondamentaux.
Technologies Clés du Transhumanisme et leurs Implications Éthiques
Le transhumanisme s'appuie sur une convergence de technologies de pointe, souvent regroupées sous l'acronyme NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives), pour atteindre ses objectifs d'amélioration humaine. Chacune de ces sphères technologiques présente des implications éthiques distinctes et des défis réglementaires.
Édition Génétique (CRISPR) et Modifications Héréditaires
L'édition génétique, particulièrement avec l'avènement de la technologie CRISPR-Cas9, a révolutionné le domaine de la génétique en permettant de modifier précisément l'ADN. Cette capacité ouvre de nouvelles voies pour le traitement des maladies génétiques, mais aussi pour l'amélioration de traits humains. La modification de la lignée germinale (c'est-à-dire des œufs, des spermatozoïdes ou des embryons précoces) est particulièrement controversée, car les changements introduits seraient transmissibles aux générations futures. Les préoccupations éthiques majeures incluent la possibilité de créer des "bébés sur mesure" (designer babies), les effets hors cible imprévus sur le génome, le phénomène de mosaïcisme (où l'édition génétique n'affecte pas toutes les cellules de l'individu), et les conséquences à long terme qui ne sont pas encore pleinement comprises. L'édition génétique présente un dilemme profond entre sa promesse thérapeutique et le spectre de l'eugénisme. D'une part, elle offre des perspectives de guérison pour des maladies génétiques graves, telles que la bêta-thalassémie ou la drépanocytose, comme en témoigne l'approbation de Casgevy au Royaume-Uni. D'autre part, la même technologie peut être utilisée pour des "améliorations" non-thérapeutiques , ce qui, combiné à la transmissibilité héréditaire des modifications, évoque des pratiques eugéniques historiques. Le Nuffield Council on Bioethics au Royaume-Uni a même suggéré que l'édition génétique héréditaire pourrait être moralement admissible pour l'amélioration si elle est compatible avec le bien-être de la future personne et la justice sociale. Cette position révèle une tension fondamentale : où doit être placée la limite entre la prévention de la souffrance et la création d'une "humanité améliorée", et qui est légitime pour prendre cette décision?
Neurotechnologies (Interfaces Cerveau-Machine, Amélioration Cognitive)
Les neurotechnologies, notamment les interfaces cerveau-machine (ICM), permettent une communication directe entre le cerveau et des dispositifs externes. Ces technologies ont un potentiel médical immense, par exemple en permettant à des personnes paralysées de restaurer la marche ou de communiquer par la pensée. Cependant, elles ont également des applications non-médicales pour l'amélioration cognitive, comme l'augmentation de la mémoire ou de l'attention. Les défis éthiques liés aux neurotechnologies sont nombreux et complexes. Ils incluent la protection de la vie privée mentale, la liberté de pensée, l'intégrité personnelle, la sécurité des données neuronales, et le risque de manipulation ou d'influence indue sur les processus de pensée. L'émergence de ces technologies a conduit à la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de droits fondamentaux : les "neurorights". L'accès aux données neuronales et la capacité des neurotechnologies à influencer la pensée et la personnalité posent des questions sans précédent sur l'autonomie et la vie privée. Le fait que des pays comme le Chili aient inscrit des "neurorights" dans leur constitution en 2021 et que l'UNESCO travaille sur une recommandation éthique pour les neurotechnologies indique une reconnaissance internationale de la nécessité de protéger ces aspects fondamentaux de l'identité humaine face à des technologies qui brouillent les frontières entre le corps, l'esprit et la machine. Cela suggère que les cadres juridiques existants sont insuffisants et qu'une nouvelle génération de droits est nécessaire pour encadrer cette "dérive" technologique.
Intelligence Artificielle et Intégration Homme-Machine
L'intelligence artificielle (IA), en particulier les grands modèles de langage (LLMs) et la robotique, est une composante clé du transhumanisme, facilitant l'amélioration cognitive et l'intégration homme-machine. L'IA est perçue comme une extension des capacités humaines plutôt qu'un simple remplacement. Les préoccupations éthiques liées à l'IA sont variées et incluent les biais algorithmiques, la prise de décision automatisée, la question de la responsabilité en cas d'erreur, la protection de la vie privée, le risque de déshumanisation des soins, et l'utilisation non autorisée de données. L'intégration de l'IA dans la prise de décision, y compris dans le domaine médical , soulève la question complexe de la responsabilité. Si l'IA opère comme une "boîte noire" (où même ses concepteurs ne comprennent pas toujours comment elle arrive à ses conclusions) , il devient difficile d'attribuer la responsabilité en cas de préjudice. Le Conseil d'Éthique Allemand insiste sur le fait que l'IA ne doit pas remplacer l'intelligence, la responsabilité ou le jugement humain, mais plutôt les soutenir. Cette situation met en évidence une dérive potentielle où l'autonomie humaine pourrait être diminuée par une dépendance excessive à l'IA, ou où la responsabilité pourrait être diluée, créant des zones grises légales et éthiques.
Prothèses Augmentées et Amélioration Physique
Les prothèses et exosquelettes ont évolué au-delà de la simple restauration de fonctions pour permettre l'amélioration des capacités physiques, parfois au-delà des limites humaines normales. Aux États-Unis, la régulation des prothèses est principalement assurée par la Food and Drug Administration (FDA), qui se concentre sur la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux destinés à remplacer une partie du corps ou sa fonction. Cependant, l'application de ces technologies à des fins d'amélioration non-thérapeutique est moins réglementée et soulève des questions sur l'accès et la "commodification" du corps humain. Le défi de la régulation des "améliorations" physiques non-thérapeutiques est manifeste. Les prothèses sont traditionnellement réglementées comme des dispositifs médicaux visant à restaurer une fonction. Cependant, le transhumanisme envisage des prothèses augmentées pour des performances "surhumaines". Le marché de ces technologies pourrait se développer en dehors des cadres médicaux stricts , créant un scénario où les avantages physiques conférés par ces dispositifs deviennent un facteur de discrimination à l'emploi ou dans la société. La législation actuelle n'est pas toujours adaptée pour distinguer ou réguler spécifiquement l'amélioration physique élective, ce qui représente une lacune potentielle dans le cadre réglementaire.
Cadres Législatifs et Réglementaires Actuels
La réponse juridique et éthique aux avancées biomédicales et aux aspirations transhumanistes se manifeste à travers un ensemble complexe d'instruments internationaux et de législations nationales, chacun reflétant des valeurs et des priorités différentes.
Instruments Internationaux et Régionaux
Les organisations internationales et régionales jouent un rôle crucial dans l'établissement de normes éthiques et de cadres réglementaires, bien que leur pouvoir contraignant puisse varier.
UNESCO (Déclarations sur le Génome Humain et la Bioéthique)
L'UNESCO considère le génome humain comme le patrimoine de l'humanité, à protéger et à transmettre aux générations futures, en veillant à ce que les progrès scientifiques soient considérés à la lumière des droits humains. La Déclaration Universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'Homme (1997) et la Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l'Homme (2005) sont des instruments clés qui affirment la dignité humaine, la non-réduction des individus à leurs caractéristiques génétiques, et l'importance du consentement éclairé. L'UNESCO a appelé à un moratoire sur l'édition du génome de la lignée germinale humaine en 2015 et travaille sur des recommandations éthiques pour les neurotechnologies et l'IA. Le rôle normatif mais non contraignant des déclarations de l'UNESCO est une caractéristique importante. Ces déclarations établissent des principes éthiques universels et des "normes de référence" mais ne sont pas des traités juridiquement contraignants en elles-mêmes. Elles "guident les décisions ou pratiques des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des sociétés". Cela signifie qu'elles fournissent un cadre moral et une base pour les législations nationales, mais leur mise en œuvre dépend de la volonté des États membres. Cette nature de "soft law" est une force pour l'adoption large de principes, mais une faiblesse pour l'application directe, ce qui peut entraîner des disparités dans la régulation des technologies transhumanistes à travers le monde.
Conseil de l'Europe (Convention d'Oviedo et Protocoles)
La Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d'Oviedo, 1997) est le premier traité international juridiquement contraignant axé sur la bioéthique. Elle donne la primauté à l'être humain sur le seul intérêt de la science ou de la société. La Convention interdit la création d'embryons humains à des fins de recherche et la sélection du sexe de l'enfant, sauf pour éviter une maladie héréditaire grave. Un protocole additionnel interdit spécifiquement le clonage d'êtres humains. Plus largement, la modification du génome humain n'est autorisée qu'à des fins préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, sans modifications transmissibles aux descendants. L'impact d'un traité contraignant comme la Convention d'Oviedo peut être variable face aux divergences nationales. Bien qu'elle soit un instrument juridiquement contraignant , elle laisse une certaine marge de manœuvre aux États signataires sur des questions spécifiques, telles que l'utilisation des embryons surnuméraires pour la recherche. Cette flexibilité reflète les "divisions éthiques" entre les positions "conservatrices" et "libérales" des États membres. Par conséquent, même avec un cadre contraignant, une harmonisation complète des lois face au transhumanisme reste un défi, permettant des approches différentes au sein de l'Europe.
Organisation Mondiale de la Santé (Lignes Directrices Éthiques)
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) promeut des normes éthiques pour la recherche impliquant des êtres humains, guidées par les principes de bienfaisance, justice et autonomie. Elle s'appuie sur des documents fondamentaux tels que la Déclaration d'Helsinki de l'Association Médicale Mondiale et les Lignes Directrices Éthiques Internationales pour la Recherche Biomédicale Impliquant des Sujets Humains. L'OMS développe également des normes mondiales de gouvernance et de surveillance de l'édition du génome de la lignée germinale et a publié des lignes directrices sur l'éthique de l'IA dans le domaine de la santé. L'OMS joue un rôle clé dans la standardisation éthique globale, mais sans pouvoir législatif direct. L'OMS établit des "normes de conduite" et des "principes éthiques" pour la recherche. Son travail sur l'édition du génome de la lignée germinale et l'IA vise à unifier les approches éthiques au niveau mondial. Cependant, à l'instar de l'UNESCO, l'OMS n'a pas de pouvoir législatif direct sur les États membres. Son influence réside dans la fourniture de "guidance normative" et d'outils de "benchmarking" , qui peuvent informer et inspirer les législations nationales, mais ne les imposent pas.
Union Européenne (Réglementations sur l'IA et les OGM)
Le Groupe Européen d'Éthique des Sciences et des Nouvelles Technologies (EGE) est un organisme indépendant qui conseille la Commission Européenne sur les questions éthiques liées à la science et aux nouvelles technologies, y compris l'édition du génome et l'IA. L'Union Européenne a adopté l' AI Act en 2024, un cadre juridique axé sur le risque qui insiste sur la "surveillance humaine" des systèmes d'IA, notamment par l'utilisation d'outils d'interface homme-machine appropriés. Les technologies d'édition génétique sont réglementées par la directive sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), imposant des contrôles stricts sur leur développement, leur commercialisation et leur utilisation. L'approche de l'UE peut être considérée comme un modèle de régulation proactive des technologies émergentes. L'AI Act de l'UE est un exemple de cadre réglementaire "produit-centrique" et "basé sur le risque", cherchant à anticiper et à encadrer les technologies d'IA. L'accent mis sur la "surveillance humaine" est une tentative de préserver l'autonomie et la responsabilité face à l'automatisation avancée. Bien que les questions bioéthiques ne soient pas directement du ressort législatif de l'UE dans leur ensemble , l'approche de l' AI Act pourrait servir de modèle pour la régulation d'autres technologies transhumanistes, en catégorisant les risques et en imposant des obligations correspondantes, ce qui représente une évolution par rapport à une approche purement réactive.
Approches Nationales Comparées
Les cadres législatifs nationaux en matière de bioéthique présentent une grande diversité, reflétant des valeurs culturelles, historiques et sociétales distinctes.
France : Lois de Bioéthique et Révisions
Les premières lois de bioéthique françaises datent de 1994, ayant été révisées en 2004, 2011 et plus récemment en 2021. La loi de 2021 a notamment ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires, et encadre l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Elle a également assoupli les conditions de la recherche sur l'embryon, passant d'un régime d'interdiction avec dérogation à une autorisation encadrée, avec une limite de 14 jours pour la culture in vitro des embryons surnuméraires. La gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France. Le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), créé en 1983 , joue un rôle central dans la réflexion éthique et l'organisation du débat public avant les révisions législatives. Le modèle français de révision périodique et de consultation publique représente une tentative institutionnalisée d'adapter le cadre légal aux avancées scientifiques et aux évolutions sociétales. Cependant, même avec ce mécanisme, les débats sont longs et complexes , et certaines questions, telles que la PMA post-mortem ou le don d'ovocytes dans un couple de femmes selon la technique ROPA, ont été rejetées malgré les discussions. Cela démontre que même un cadre dynamique peut peiner à suivre le rythme des innovations et des demandes sociétales les plus radicales du transhumanisme.
Royaume-Uni : Réglementation de la Fertilité et de la Recherche Embryonnaire
Le Royaume-Uni est reconnu comme un leader mondial dans la régulation des traitements de fertilité et de la recherche impliquant des embryons humains. Le Human Fertilisation and Embryology (HFE) Act 1990, mis à jour en 2008, a été la première loi de ce type au monde. Cette loi a établi la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qui délivre des licences pour la recherche sur les embryons (limitée à 14 jours de développement) et interdit l'implantation d'embryons modifiés à des fins de grossesse. La modification génétique de la lignée germinale est permise pour la recherche, mais illégale à des fins reproductives. La thérapie de remplacement mitochondrial (souvent appelée IVF à "trois parents") est permise si elle est jugée dans l'intérêt de l'enfant futur. Plus récemment, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver Casgevy, une thérapie basée sur CRISPR pour deux troubles sanguins. L'approche pragmatique du Royaume-Uni peut être vue comme un laboratoire de la bioéthique, avec des lignes rouges claires mais évolutives. Le pays se distingue par une approche qui semble plus permissive pour la recherche sur l'embryon et l'édition génétique à des fins thérapeutiques , tout en maintenant des interdictions strictes pour les applications reproductives de l'édition germinale. L'autorisation de la thérapie de remplacement mitochondrial est un exemple de flexibilité, mais elle est encadrée par des critères d'intérêt de l'enfant et de non-aggravation des inégalités. Cela suggère une volonté d'explorer les bénéfices potentiels des technologies tout en tentant de contenir les "dérives" les plus controversées, mais la ligne entre "thérapie" et "amélioration" demeure un défi constant.
Allemagne : Protection de l'Embryon et Recherche sur les Cellules Souches
L'Allemagne possède l'une des législations les plus restrictives en ce qui concerne la recherche sur les embryons. L'Embryo Protection Act (Embryonenschutzgesetz) 1991 criminalise la dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires. Le droit constitutionnel allemand protège la dignité humaine et le droit à la vie, des principes qui s'étendent à l'embryon. L'importation de lignées de cellules souches embryonnaires est permise sous des conditions strictes (notamment une date limite de dérivation) et uniquement pour des recherches jugées vitales. En ce qui concerne la fin de vie, l'euthanasie active est interdite et considérée comme un homicide en Allemagne. L'assistance au suicide est autorisée lorsqu'elle est effectuée par un individu, mais elle était interdite si elle était pratiquée par une organisation professionnelle. Cependant, la Cour Constitutionnelle Fédérale a jugé cette interdiction inconstitutionnelle en 2020, affirmant un droit à une mort autodéterminée. L'ancrage constitutionnel de la dignité humaine en Allemagne agit comme un frein aux dérives transhumanistes. La protection constitutionnelle de la dignité humaine et du droit à la vie a conduit à l'une des législations les plus restrictives sur l'embryon et la recherche sur les cellules souches. Cela démontre comment des principes fondamentaux forts peuvent agir comme un rempart contre les applications les plus radicales du transhumanisme, en particulier celles qui touchent au début de la vie humaine et à l'intégrité de l'être. Néanmoins, même en Allemagne, le débat sur la fin de vie montre une évolution des interprétations de l'autonomie face à la dignité.
Chine : Cadre Réglementaire sur l'Édition du Génome Humain
La Chine a significativement renforcé sa supervision de l'édition du génome humain, en particulier après l'incident He Jiankui en 2018, au cours duquel des embryons humains avaient été génétiquement modifiés et portés à terme. En réponse à cet événement, le Code Civil de 2020 et un amendement au Droit Pénal interdisent l'édition du génome humain et le clonage sans exception, avec des sanctions pénales pour les contrevenants. L'accès aux technologies de procréation assistée (ART) est relativement restrictif en Chine, étant limité aux couples hétérosexuels mariés et au traitement de l'infertilité. Cependant, des efforts sont en cours pour assouplir ces restrictions pour les femmes célibataires. L'incident He Jiankui a servi de catalyseur pour une régulation plus stricte en Chine, avec des implications pour la "course" technologique mondiale. Cet événement a eu un impact mondial, entraînant un appel à un moratoire international sur l'édition du génome germinal. En Chine, cela a conduit à un renforcement significatif des lois pénales. Cela illustre comment une dérive éthique majeure peut provoquer une réaction législative rapide et sévère, transformant un domaine peu réglementé en un domaine fortement interdit. Cette situation soulève également la question de la "course" à l'innovation et du risque que des chercheurs se déplacent vers des juridictions moins réglementées, un phénomène parfois appelé "tourisme éthique".
États-Unis : Lois sur la Non-Discrimination Génétique et la Recherche
Aux États-Unis, il n'existe pas de loi fédérale explicite interdisant l'édition du génome germinal, mais le financement fédéral pour la recherche sur la modification du génome humain destinée à la grossesse est interdit. Le Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) de 2008 interdit la discrimination génétique dans l'assurance maladie et l'emploi. Le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) protège la confidentialité des données de santé, mais les nouvelles données neuronales issues des dispositifs de neurotechnologie grand public sont moins bien couvertes par ce cadre. La régulation des prothèses est principalement assurée par la FDA, qui se concentre sur la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux. Le cadre réglementaire américain est caractérisé par sa fragmentation et sa réactivité. L'approche est hétérogène, avec différentes agences et lois couvrant divers aspects de l'édition génétique et des technologies biomédicales. L'absence d'une interdiction fédérale explicite de l'édition germinale financée par des fonds privés contraste avec d'autres pays et pourrait potentiellement permettre des dérives dans le secteur privé. Les défis liés à la protection des données neuronales illustrent également la difficulté pour les lois existantes à s'adapter à des technologies qui évoluent plus vite que les cadres juridiques, soulignant la nécessité de "neurorights" et d'une approche fédérale cohérente.
Canada : Procréation Assistée et Aide Médicale à Mourir
La Loi sur la Procréation Assistée (AHRA) de 2004 réglemente la procréation assistée au Canada, criminalisant le paiement pour le sperme, les ovules ou les services de mères porteuses afin d'éviter la commercialisation de la reproduction. La modification du génome d'une cellule humaine ou d'un embryon in vitro transmissible aux descendants est interdite. L'aide médicale à mourir (AMM) est légale au Canada depuis juin 2016, avec des modifications apportées en 2021 pour inclure les cas où la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. L'extension de l'AMM aux personnes souffrant uniquement de maladie mentale a été retardée jusqu'en mars 2027. Le consentement éclairé est un principe fondamental dans le processus d'AMM. Le Canada est un exemple de législation progressiste mais prudente face aux questions de fin de vie et d'intégrité génétique. Le pays a une législation relativement avancée sur des questions bioéthiques complexes comme l'AMM , mais fait preuve de prudence sur l'extension de l'AMM aux maladies mentales. L'interdiction de la modification du génome transmissible et la criminalisation de la commercialisation de la reproduction démontrent une volonté de prévenir la "commodification" de la vie humaine et les dérives eugéniques. Cela illustre une approche qui cherche à équilibrer l'autonomie individuelle avec des considérations de dignité humaine et de protection de la société.
Exemples d'autres juridictions (Brésil, Japon, Afrique)
Les cadres réglementaires nationaux varient considérablement, reflétant des valeurs culturelles et sociales diverses.
- Brésil : La Loi n° 14.874/2024 régule la recherche sur les sujets humains, transférant la supervision au Secrétariat de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Elle modifie les responsabilités des sponsors en matière de soins de santé et d'accès post-essai, réduisant le fardeau mais limitant l'accès post-essai aux produits expérimentaux plutôt qu'aux "meilleures méthodes prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques". La loi brésilienne sur la biosécurité permet implicitement certaines recherches sur l'édition génétique somatique.
- Japon : La Loi sur les Technologies de Reproduction Assistée (2020) reconnaît les couples mariés hétérosexuels comme parents légaux via don de gamètes, mais ne reconnaît pas le droit des enfants d'accéder à l'identité de leurs donneurs. La Loi sur la Transplantation d'Organes (1997, révisée en 2010) a légalisé le prélèvement d'organes sur des donneurs en état de mort cérébrale avec consentement familial, mais une méfiance culturelle persiste.
- Afrique : Les systèmes éthiques doivent prévenir l'abus des technologies comme CRISPR dans les pays en développement, en incorporant les idéaux africains, tels que le communautarisme, dans les cadres bioéthiques internationaux. Il existe un besoin d'accélérer l'adoption de lois régulant l'édition germinale.
La diversité des approches nationales et l'importance du contexte culturel sont manifestes. Ces exemples illustrent une grande variété dans les cadres réglementaires nationaux, reflétant des valeurs culturelles et sociales différentes. Au Japon, la méfiance culturelle a longtemps freiné le don d'organes. Au Brésil, la nouvelle loi sur la recherche clinique a des implications pour la protection des participants. En Afrique, l'accent sur le communautarisme contraste avec l'individualisme occidental, ce qui doit être pris en compte dans l'élaboration de cadres éthiques. Cette diversité souligne que les dérives du transhumanisme ne seront pas abordées de manière uniforme, et que des solutions adaptées au contexte sont nécessaires, rendant l'harmonisation internationale plus complexe.
Table 1 : Comparaison des Réglementations Clés sur l'Édition Génétique Héréditaire (par Juridiction)
Cette table offre une vue d'ensemble comparative et synthétique des positions légales sur l'édition génétique héréditaire, un point névralgique de la dérive transhumaniste. Elle met en évidence la diversité des approches réglementaires, allant de l'interdiction stricte à l'autorisation de la recherche sous conditions. Elle relie ces différences aux principes éthiques sous-jacents, tels que la dignité humaine, le consentement et la prévention de l'eugénisme. En visualisant où les aspirations transhumanistes de "designer babies" ou d'amélioration héréditaire se heurtent aux cadres juridiques existants, elle permet d'identifier rapidement les lacunes ou les zones grises. Cette comparaison révèle une tendance générale à l'interdiction ou à la restriction sévère de l'EGH à des fins reproductives au niveau international et dans de nombreux pays, soulignant une prudence face aux modifications irréversibles du patrimoine génétique humain.
La Dérive Potentielle du Transhumanisme : Défis Éthiques et Lacunes Législatives
Le transhumanisme, par ses objectifs d'amélioration radicale de la condition humaine, confronte les cadres bioéthiques et législatifs existants à des défis inédits, révélant des frontières floues et des lacunes réglementaires.
La Distinction Thérapeutique vs. Amélioration Non-Thérapeutique : Une Frontière Floue
Le transhumanisme vise à améliorer la condition humaine au-delà de la simple thérapie. Cette distinction est fondamentale pour la régulation, mais elle est intrinsèquement difficile à définir et à maintenir. Ce qui est considéré comme une "maladie" ou une "déficience" peut évoluer avec le temps et les capacités technologiques. La "médicalisation" de la condition humaine normale est une porte d'entrée pour l'amélioration non-thérapeutique. Le transhumanisme tend à considérer le vieillissement ou les limitations humaines "normales" comme des "maladies" à "surmonter". Si la médecine adopte cette perspective, la distinction entre thérapie et amélioration s'estompe, car toute "amélioration" pourrait être justifiée comme le traitement d'une "condition" nouvellement définie. Cela risque de transformer la médecine, traditionnellement axée sur la restauration de la santé, en un outil d'ingénierie humaine, ouvrant la voie à des interventions radicales sans un cadre éthique adéquat pour l'amélioration.
Risques d'Inégalités Sociales, de Commodification et d'Eugénisme
L'accès inégal aux technologies d'amélioration, souvent coûteuses, pourrait créer une "fracture transhumaine" entre les "améliorés" et les "non-améliorés", exacerbant les inégalités existantes. La commercialisation de la reproduction, comme la gestation pour autrui (GPA) ou la vente de gamètes, est une préoccupation majeure, avec des législations comme celle du Canada qui la criminalisent pour éviter la "commodification" de la vie humaine. Le transhumanisme, en promouvant la "procréation bénéfique", pourrait encourager des pratiques qui, bien que volontaires, s'apparentent à de l'eugénisme si elles visent à sélectionner ou modifier des traits désirables. Il existe une tension inhérente entre la liberté individuelle de "s'améliorer" et l'impératif de justice sociale. Le transhumanisme met en avant la "liberté de choix individuelle" concernant l'utilisation des technologies d'amélioration. Cependant, cette liberté, si elle n'est pas encadrée, peut entrer en conflit direct avec le principe de justice , car elle risque d'accroître les inégalités sociales. La "tyrannie de l'optimisation" pourrait exercer une pression sociale sur les individus pour qu'ils adoptent des améliorations afin de rester compétitifs, même s'ils ne le souhaitent pas ou n'en ont pas les moyens, transformant ainsi la liberté en contrainte.
Questions d'Identité Humaine, de Déshumanisation et de "Slippery Slope"
Les interventions radicales sur le corps et l'esprit, notamment l'intégration homme-machine, soulèvent des questions fondamentales sur ce qui définit l'essence de l'être humain et le risque de déshumanisation. La "colonisation de l'identité" et la perte de l'autonomie sont des préoccupations majeures. Le concept de "pente glissante" (slippery slope) est souvent évoqué, exprimant la crainte que des améliorations initialement acceptables ne mènent progressivement à des interventions plus extrêmes et moralement problématiques. La redéfinition de la "personne" et ses implications juridiques et éthiques est un enjeu central. Si le transhumanisme conduit à la création d'êtres "posthumains" ou de "cyborgs" , la question se pose de savoir si ces entités acquièrent une "personnalité juridique" et quels droits leur seraient accordés. La "Déclaration Transhumaniste" elle-même plaide pour le bien-être de "toute entité sentiente", y compris les intelligences artificielles et les formes de vie modifiées. Cela remet en question les fondements du droit actuel, qui est souvent basé sur la notion d'être humain, et pourrait entraîner des conflits éthiques et légaux sans précédent concernant la définition de la vie, de la conscience et des droits.
Défis en matière de Confidentialité des Données et de Responsabilité Légale
La collecte et l'analyse de données biométriques, génétiques et neuronales par les technologies transhumanistes posent des risques importants pour la vie privée et la sécurité des données. La question de la responsabilité légale en cas de dysfonctionnement ou de préjudice causé par des technologies d'amélioration (par exemple, des implants cérébraux ou des systèmes d'IA) est complexe, surtout avec les systèmes fonctionnant comme des "boîtes noires". L'obsolescence des cadres de protection de la vie privée face aux "données sensibles" émergentes est une préoccupation croissante. Les lois existantes sur la vie privée, telles que l'HIPAA aux États-Unis ou le GDPR en Europe, ont été conçues pour des types de données plus conventionnels. Les neurotechnologies, en particulier, génèrent des données d'une intimité et d'une granularité sans précédent , remettant en question la distinction entre données "personnelles" et "sensibles". Le risque de "commodification" de ces données et leur utilisation abusive pour la discrimination nécessite une refonte des lois sur la vie privée pour inclure explicitement les "neurorights" et des mesures de consentement plus robustes et révocables.
L'Écart entre l'Avancement Technologique et l'Adaptation Législative
La vitesse des innovations technologiques dépasse souvent la capacité des cadres législatifs à s'adapter. Les lois sont souvent réactives, promulguées après que les technologies ont déjà commencé à être utilisées ou après des incidents éthiques majeurs. Le besoin urgent de cadres réglementaires "à l'épreuve du futur" et de gouvernance adaptative est manifeste. Le décalage entre la rapidité de l'innovation et la lenteur de la législation est une constante. Pour éviter que les dérives transhumanistes ne deviennent irréversibles, il est impératif de passer d'une approche réactive à une approche proactive. Cela implique de développer des "cadres réglementaires à l'épreuve du futur" , qui peuvent s'adapter aux nouvelles technologies sans nécessiter une refonte complète à chaque innovation. La mise en place de "corps de surveillance interdisciplinaires" et de "débats publics continus" est cruciale pour anticiper les défis et orienter le développement technologique de manière éthique.
Table 2 : Défis Éthiques Majeurs du Transhumanisme et Principes Bioéthiques Concernés
Cette table systématise les principales préoccupations éthiques soulevées par le transhumanisme et les met en regard des principes bioéthiques fondamentaux. Elle facilite la compréhension de la nature multifacette de la "dérive potentielle" et de la manière dont elle interagit avec la pensée bioéthique établie. En reliant chaque défi à des principes spécifiques et aux données de recherche, elle fournit une grille d'analyse structurée pour évaluer les implications éthiques et les lacunes législatives.
Recommandations et Perspectives d'Avenir
Face à la complexité des enjeux soulevés par le transhumanisme et la rapidité des avancées technologiques, l'élaboration de réponses bioéthiques et législatives robustes est impérative. Une approche proactive et collaborative est essentielle pour prévenir les dérives potentielles.
Nécessité d'un Dialogue Public Continu et Inclusif
Un dialogue public soutenu et inclusif est fondamental pour façonner des politiques bioéthiques acceptables et légitimes. Les débats sur la bioéthique ne doivent pas être des événements isolés, mais un processus continu, impliquant une diversité de voix, y compris les jeunes, les personnes âgées, et les groupes vulnérables. L'expérience française avec le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) et ses consultations publiques illustre l'importance d'une telle démarche pour éclairer les décisions législatives. Ce dialogue permet d'anticiper les valeurs, les espoirs et les craintes du public, orientant ainsi l'innovation dans une direction socialement acceptable.
Harmonisation des Cadres Réglementaires Internationaux
La nature transnationale des avancées technologiques, comme l'édition du génome ou les neurotechnologies, rend l'harmonisation des cadres réglementaires internationaux indispensable. Des disparités législatives peuvent conduire au "tourisme éthique", où des recherches controversées sont menées dans des juridictions moins réglementées. Les instruments internationaux existants, tels que la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe et les déclarations de l'UNESCO , fournissent une base, mais leur application et leur portée doivent être renforcées. La coopération entre les États, les organisations internationales (comme l'OMS et l'UNESCO) et les comités d'éthique nationaux est cruciale pour établir des normes communes et prévenir une "course vers le bas" réglementaire.
Développement de Principes Éthiques Adaptatifs et de Mécanismes de Gouvernance
Les cadres réglementaires doivent être "à l'épreuve du futur" , capables de s'adapter aux technologies émergentes sans nécessiter une refonte complète à chaque innovation. Cela implique le développement de principes éthiques adaptatifs, qui peuvent guider la prise de décision dans des contextes d'incertitude scientifique et de valeurs conflictuelles. La mise en place de mécanismes de gouvernance adaptatifs, tels que des comités d'éthique interdisciplinaires composés d'experts en médecine, droit, philosophie et sciences sociales , est essentielle. Ces organismes devraient avoir la capacité de réviser et d'ajuster les lignes directrices au fur et à mesure que les connaissances scientifiques et les implications sociétales évoluent. L'approche basée sur le risque de l' AI Act de l'UE pourrait servir de modèle pour d'autres technologies transhumanistes.
Renforcement de la Surveillance et de l'Évaluation des Technologies
Une surveillance rigoureuse et une évaluation continue des technologies sont nécessaires pour identifier et atténuer les risques potentiels. Cela inclut la mise en place de systèmes de suivi des essais cliniques, la protection renforcée des données sensibles (notamment les données neuronales, nécessitant potentiellement des "neurorights" spécifiques) et l'établissement de cadres de responsabilité clairs pour les systèmes autonomes. Il est également vital de distinguer clairement les applications thérapeutiques des améliorations non-thérapeutiques et d'encadrer ces dernières avec la plus grande prudence, voire de les interdire si les risques pour la dignité humaine, la justice sociale ou l'identité sont jugés inacceptables.
Conclusion
Le transhumanisme, avec sa vision d'une humanité radicalement améliorée par la technologie, pose des défis existentiels aux fondements de la bioéthique et du droit. La tension inhérente entre la vitesse de l'innovation scientifique et la lenteur de l'adaptation législative crée un terrain fertile pour des dérives potentielles. Ces dérives se manifestent à travers la frontière floue entre la thérapie et l'amélioration, les risques d'inégalités sociales et d'eugénisme, les questions profondes d'identité et de déshumanisation, ainsi que les défis complexes liés à la confidentialité des données et à la responsabilité légale. Les cadres juridiques et éthiques existants, qu'ils soient internationaux (UNESCO, Conseil de l'Europe, OMS) ou nationaux (France, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, États-Unis, Canada, etc.), tentent d'encadrer ces avancées avec des approches variées, allant de l'interdiction stricte de la modification du génome héréditaire à des régulations plus permissives pour la recherche. Cependant, aucun système n'est pleinement préparé à la portée et à la rapidité des transformations envisagées par le transhumanisme. Pour naviguer dans cette ère de profondes mutations, il est impératif d'adopter une approche proactive et éthiquement fondée. Cela nécessite un dialogue public continu et inclusif, une harmonisation accrue des cadres réglementaires internationaux, le développement de principes éthiques adaptatifs et de mécanismes de gouvernance agiles, ainsi qu'un renforcement de la surveillance et de l'évaluation des technologies. L'objectif ultime doit être de garantir que les progrès scientifiques servent le bien-être de l'humanité dans son ensemble, en protégeant la dignité humaine, l'autonomie, la justice et la non-maléficence, tout en évitant les écueils d'une "dérive" qui pourrait compromettre l'essence même de notre humanité.
Sources des citations
- COMMITTEE ON BIOETHICS (DH-BIO) - https: //rm. coe. int, consulté le juillet 6, 2025, https://rm.coe.int/guide-ee-final-e/16809ce642
- Modernising fertility law - HFEA, consulté le juillet 6, 2025, https://www.hfea.gov.uk/about-us/modernising-the-regulation-of-fertility-treatment-and-research-involving-human-embryos/modernising-fertility-law/
- Regulatory framework of human germline and heritable genome editing in China: a comparison with the United States and the United Kingdom - PubMed Central, consulté le juillet 6, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12069028/
- Les questions de bioéthique : la chronologie de 1983 à 2023 | vie-publique.fr, consulté le juillet 6, 2025, https://www.vie-publique.fr/eclairage/19234-les-questions-de-bioethique-la-chronologie-de-1983-2023
- Transhumanism - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
- Transhumanism | Definition, History, Ethics, Philosophy, & Facts | Britannica, consulté le juillet 6, 2025, https://www.britannica.com/topic/transhumanism
- Ethical Issues in Transhumanism: Medicine & Healthcare Book Chapter - IGI Global, consulté le juillet 6, 2025, https://www.igi-global.com/chapter/ethical-issues-in-transhumanism/273073
- Human Dignity and Bioethics:Essays Commissioned by the President's Council on Bioethics (Chapter 7: Human Dignity and the Future of Man), consulté le juillet 6, 2025, https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/human_dignity/chapter7.html
- Bioethics and Transhumanism | Request PDF - ResearchGate, consulté le juillet 6, 2025, https://www.researchgate.net/publication/317790169_Bioethics_and_Transhumanism
- TRANSHUMANISM: MORALITY AND LAW AT THE FRONTIER OF THE HUMAN CONDITION, consulté le juillet 6, 2025, https://www.avemarialaw.edu/wp-content/uploads/2022/09/Cummings-Proof.pdf
- Bioethics and Transhumanism | The Journal of Medicine and Philosophy - Oxford Academic, consulté le juillet 6, 2025, https://academic.oup.com/jmp/article/42/3/237/3817401
- Ethical editing: therapeutics and 'enhancement' - Genomics Education Programme, consulté le juillet 6, 2025, https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/blog/ethical-editing-therapeutics-and-enhancement/
- Rewriting the human genome, rewriting human rights law? Human rights, human dignity, and human germline modification in the CRISPR era | Journal of Law and the Biosciences | Oxford Academic, consulté le juillet 6, 2025, https://academic.oup.com/jlb/article/7/1/lsaa006/5841599
- Transhumanism and Human Enhancement — A Journey Beyond Human Limits, consulté le juillet 6, 2025, https://www.gsdvs.com/post/transhumanism-and-human-enhancement-a-journey-beyond-human-limits
- What does Transhumanism Mean for Human Rights?, consulté le juillet 6, 2025, https://ishr.org/what-does-transhumanism-mean-for-human-rights/
- Human enhancement and functional diversity: Ethical concerns of emerging technologies and transhumanism - Redalyc, consulté le juillet 6, 2025, https://www.redalyc.org/journal/5117/511769287027/html/
- HUMAN ENHANCEMENT – A Discussion Document - Conference of European Churches, consulté le juillet 6, 2025, https://ceceurope.org/storage/app/media/uploads/2015/12/Human_Enhancement_March_10.pdf
- Bioethics and End-of-Life Law: A Comprehensive Overview - Number Analytics, consulté le juillet 6, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/bioethics-end-of-life-law-comprehensive-overview
- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights - Legal Affairs - UNESCO, consulté le juillet 6, 2025, https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-bioethics-and-human-rights
- Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme - Cairn, consulté le juillet 6, 2025, https://shs.cairn.info/article/RISS_186_0811/pdf?lang=fr
- Bioethics - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics
- The Transhuman in the Workplace: Maximising Autonomy and Avoiding the Tyranny of Optimisation | Request PDF - ResearchGate, consulté le juillet 6, 2025, https://www.researchgate.net/publication/364031230_The_Transhuman_in_the_Workplace_Maximising_Autonomy_and_Avoiding_the_Tyranny_of_Optimisation
- Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine - Institut Européen de Bioéthique, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ieb-eib.org/fr/loi/recherche-biomedicale/recherche-medicale/convention-sur-les-droits-de-l-homme-et-la-biomedecine-134.html
- Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme | OHCHR, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-human-genome-and-human-rights
- Human dignity and transhumanism: do anthro-technological devices have moral status?, consulté le juillet 6, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20582831/
- Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme | UNESCO, consulté le juillet 6, 2025, https://www.unesco.org/fr/ethics-science-technology/human-genome-and-human-rights
- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights | UNESCO, consulté le juillet 6, 2025, https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/human-genome-and-human-rights
- Ensuring ethical standards and procedures for research with human beings, consulté le juillet 6, 2025, https://www.who.int/activities/ensuring-ethical-standards-and-procedures-for-research-with-human-beings
- Assisted Human Reproduction Act ( SC 2004, c. 2) - Laws.justice.gc.ca, consulté le juillet 6, 2025, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-13.4/page-1.html
- Medical assistance in dying: Overview - Canada.ca, consulté le juillet 6, 2025, https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-services-benefits/medical-assistance-dying.html
- Medical Assistance in Dying - Provincial Health Services Authority, consulté le juillet 6, 2025, http://www.phsa.ca/health-info/medical-assistance-in-dying
- Human genetic enhancement - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_enhancement
- Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven healthcare - PMC, consulté le juillet 6, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7332220/
- UN Finalizes Neurotech Ethics Draft, To Be Adopted at General Conference - The Sociable, consulté le juillet 6, 2025, https://sociable.co/government-and-policy/un-neurotech-ethics/
- Genetic Enhancement: The Law Explained - Number Analytics, consulté le juillet 6, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/genetic-enhancement-law-guide
- Ethical Issues: Germline Gene Editing | ASGCT, consulté le juillet 6, 2025, https://patienteducation.asgct.org/patient-journey/ethical-issues-germline-gene-editing
- Human germline engineering - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Human_germline_engineering
- United States: Germline / Embryonic - Global Gene Editing Regulation Tracker, consulté le juillet 6, 2025, https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/united-states-embryonic-germline-gene-editing/
- Convention d'Oviedo et ses Protocoles - Droits Humains et Biomédecine, consulté le juillet 6, 2025, https://www.coe.int/fr/web/human-rights-and-biomedicine/oviedo-convention
- Ethics - World Health Organization (WHO), consulté le juillet 6, 2025, https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health
- Ethics of artificial intelligence - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_artificial_intelligence
- Transhumanism Ethics: A Critical Analysis of AI Technology Development and Its Implications for Humanity | Journal of Islamic Thought and Philosophy, consulté le juillet 6, 2025, https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JITP/article/view/3142
- Transhumanism Market: The Next Step in Human Evolution-Emerging Growth, Share and forecast 2029, consulté le juillet 6, 2025, https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/transhumanism-market/213956/
- interdisciplinary dialogue: a moral standard for the development of transhumanism - ACJOL.Org, consulté le juillet 6, 2025, https://acjol.org/index.php/owijoppa/article/download/4557/4445
- The Debate Over Transhumanism - Smith College, consulté le juillet 6, 2025, https://www.smith.edu/news-events/news/debate-over-transhumanism
- Human Enhancement: Scientific and Ethical Dimensions of Genetic Engineering, Brain Chips and Synthetic Blood - Pew Research Center, consulté le juillet 6, 2025, https://www.pewresearch.org/science/2016/07/26/human-enhancement-the-scientific-and-ethical-dimensions-of-striving-for-perfection-2/
- Genetics Legislation | Human Genome Project, consulté le juillet 6, 2025, https://doe-humangenomeproject.ornl.gov/genetics-legislation/
- Mind over Machine: Navigating the Legal and Ethical Frontier of Neurotech, consulté le juillet 6, 2025, https://petrieflom.law.harvard.edu/2025/02/27/mind-over-machine-navigating-the-legal-and-ethical-frontier-of-neurotech/
- Bioethics News Stories (January–June 2024) | Dignitas Vol. 31, No. 1-2 (Spring/Summer 2024), consulté le juillet 6, 2025, https://www.cbhd.org/dignitas-articles/bioethics-news-stories-january-june-2024
- Law and Ethics of Gene Editing - Number Analytics, consulté le juillet 6, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/law-and-ethics-of-gene-editing
- Moral reasons to edit the human genome: picking up from the Nuffield report - PMC, consulté le juillet 6, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6820147/
- International Research Oversight and Regulations - Human Genome Editing - NCBI, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK447261/
- Human enhancement - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Human_enhancement
- Ethical and Legal Challenges of Neurotech | DLA Piper, consulté le juillet 6, 2025, https://www.dlapiper.com/insights/publications/2025/03/ethical-and-legal-challenges-of-neurotech
- The Ethical risks of AI - UNESCO Digital Library, consulté le juillet 6, 2025, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265258
- Towards an International Instrument | UNESCO, consulté le juillet 6, 2025, https://www.unesco.org/en/ethics-neurotech/recommendation
- The Ethics of Personal Identity: Why the merging of man and machine requires a new discussion of what defines us as human individuals - Bernstein Center Freiburg, consulté le juillet 6, 2025, https://www.bcf.uni-freiburg.de/news/2016/20160726_Transhumanismus
- (PDF) ETHICAL AND SOCIETAL IMPLICATIONS OF ..., consulté le juillet 6, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377549865_ETHICAL_AND_SOCIETAL_IMPLICATIONS_OF_TRANSHUMANISM_AND_TECHNOLOGIES_OF_THE_FOURTH_INDUSTRIAL_REVOLUTION
- Principles for the Ethical Use of Artificial Intelligence in the United Nations System, consulté le juillet 6, 2025, https://unsceb.org/principles-ethical-use-artificial-intelligence-united-nations-system
- A Bionic hand that sees - UNESCO Digital Library, consulté le juillet 6, 2025, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265239
- Ethics Council: Artificial intelligence must not diminish human flourishing, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ethikrat.org/en/press/press-releases/ethics-council-artificial-intelligence-must-not-diminish-human-flourishing/
- OVERVIEW ON THE REGULATORY PATHWAY FOR PROSTHESIS IN U.S.A AND CURRENT ETHICAL ASPECTS OF PROSTHETIC CARE - RJPN, consulté le juillet 6, 2025, https://rjpn.org/ijcspub/papers/IJCSP23C1064.pdf
- Prosthetics & Orthotics, Prosthetic Devices, & Therapeutic Shoes - CMS, consulté le juillet 6, 2025, https://www.cms.gov/medicare/payment/fee-schedules/durable-medical-equipment-prosthetic-devices-prosthetics-orthotics-supplies/prosthetics-orthotics-prosthetic-devices-therapeutic-shoes
- 21 CFR Part 890 Subpart D -- Physical Medicine Prosthetic Devices - eCFR, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-H/part-890/subpart-D
- If Advanced Prosthetics Become the New 'Upgrade,' What Laws Would Follow? : r/Cyberpunk - Reddit, consulté le juillet 6, 2025, https://www.reddit.com/r/Cyberpunk/comments/1irbt91/if_advanced_prosthetics_become_the_new_upgrade/
- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights | UNESCO, consulté le juillet 6, 2025, https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/bioethics-and-human-rights
- Global Responsibilities and Bioethics: Reflections on the Council of Europe's Bioethics Convention - Digital Repository @ Maurer Law, consulté le juillet 6, 2025, https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1114&context=ijgls&httpsredir=1&referer=
- The Convention on Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe - PubMed, consulté le juillet 6, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11660358/
- BIOETHICS IN THE EUROPEAN UNION!, consulté le juillet 6, 2025, https://www.comece.eu/overview-report-on-bioethics-in-the-eu-en/
- United Kingdom: Germline / Embryonic - Global Gene Editing Regulation Tracker, consulté le juillet 6, 2025, https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/united-kingdom-germline-embryonic/
- European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), consulté le juillet 6, 2025, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/european-group-ethics_en
- The AI Act requires human oversight - BearingPoint, consulté le juillet 6, 2025, https://www.bearingpoint.com/en/insights-events/insights/the-ai-act-requires-human-oversight/
- Loi 2 août 2021 bioéthique, PMA | vie-publique.fr, consulté le juillet 6, 2025, https://www.vie-publique.fr/loi/268659-loi-2-aout-2021-bioethique-pma
- French Bioethics Law: an original participatory approach for the National Bioethics Consultation - News from the Institut Pasteur, consulté le juillet 6, 2025, https://www.pasteur.fr/en/home/research-journal/reports/french-bioethics-law-original-participatory-approach-national-bioethics-consultation
- The 2018 National Consultation on Bioethics, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2024-02/Synthe%CC%80se%20anglaise%20def.pdf
- the Human Fertilisation and Embryology (HFE) Act 1990 - Parliament UK, consulté le juillet 6, 2025, https://publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmsctech/272/27205.htm
- New Approach to Gene Editing in England, consulté le juillet 6, 2025, https://www.mfat.govt.nz/en/trade/mfat-market-reports/new-approach-to-gene-editing-in-england
- Regulation of stem cell research in Germany - EuroStemCell, consulté le juillet 6, 2025, https://www.eurostemcell.org/regulation-stem-cell-research-germany
- The German Stem Cell Law: Contents and Criticism - Brigitte Jansen / JŸrgen Simon - Eubios Ethics Institute, consulté le juillet 6, 2025, https://www.eubios.info/EJ146/ej146i.htm
- en.wikipedia.org, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_euthanasia#:~:text=Passive%20euthanasia%20is%20legal%20in,lethal%20compound%20administration%2C%20are%20illegal.
- Germany - The World Federation of Right to Die Societies, consulté le juillet 6, 2025, https://wfrtds.org/worldmap/germany/
- Procreative rights denied? Access to assisted reproduction technologies by single women in China | Journal of Law and the Biosciences | Oxford Academic, consulté le juillet 6, 2025, https://academic.oup.com/jlb/article/8/1/lsaa084/6145903
- Human Rights Violation or Paternalism - Global Bioethics Initiative (GBI), consulté le juillet 6, 2025, https://globalbioethics.org/2016/02/26/human-rights-violation-or-paternalism/
- Brazil enacts a law to regulate clinical trials | International Bar Association, consulté le juillet 6, 2025, https://www.ibanet.org/Brazil-enacts-new-law-to-regulate-clinical-trials
- Does Law 14874, A New Ethical Regulation of Research with Human Beings in Brazil, Violate Human Rights? - Revistas Comillas, consulté le juillet 6, 2025, https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/download/21812/19373/52562
- Japan's New Law on Assisted Reproductive Technology (ART). Why Did it Take Almost 20 years for Japan to Approve its First Law Regarding ART?, consulté le juillet 6, 2025, https://scitechasia.org/webinars/japans-new-law-on-assisted-reproductive-technology/
- Act on Assisted Reproductive Technology Offering and the Special Provisions of the Civil Code Related to the Parent-Child Relationship of a Child Born As a Result of the Treatment - Japanese Law Translation, consulté le juillet 6, 2025, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4367/en
- Organ transplantation in Japan - Wikipedia, consulté le juillet 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation_in_Japan
- New Organ Transplant Policies in Japan, Including the Family-Oriented Priority Donation Clause - Declaration of Istanbul, consulté le juillet 6, 2025, https://www.declarationofistanbul.org/images/stories/Downloads/articles/policy/organtransplantpoliciesinjapan-transplantation2011.pdf
- Re-Emphasizing African Bioethics in Light of Potential CRISPR-Based Treatment for HIV and Sickle Cell Disease - Scholarship@Vanderbilt Law, consulté le juillet 6, 2025, https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2722&context=vjtl
- Transhumanism and global governance of human genome editing ..., consulté le juillet 6, 2025, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-21662023000401089&lng=es&nrm=iso&tlng=en
- What is transhumanism? - Nick Bostrom, consulté le juillet 6, 2025, https://nickbostrom.com/old/transhumanism
- Bioethics committees and governance | Technology and Policy Class Notes - Fiveable, consulté le juillet 6, 2025, https://library.fiveable.me/technology-policy/unit-9/bioethics-committees-governance/study-guide/QiA8ieNS6xE6WtZd
- Vile Sovereigns in Bioethical Debate - Disability Studies Quarterly, consulté le juillet 6, 2025, https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/3870/3406
